ARÈNE POLITIQUE, NOTRE TISSU SOCIAL EN BERNE
- Pensees Poetiques
- 23 mars
- 8 min de lecture
« Sénégalmooy sonko », une du Quotidien de Madiambal Diagne du 18 novembre 2024.

Qui l’aurait cru ? Aussi invraisemblable que la maturité politique du peuple de Touba. Allant de la période pré-électorale au jour du scrutin. Qu’en est-il de celle des Sénégalais de manière globale ? Violences (verbales comme physiques), invectives, insultes, calomnies… sont toutes autant d’incongruités qui font miroir des tares de notre vie sociale de tous les jours. Si tous ces concepts péjoratifs sont malheureusement, par le fruit d'une coïncidence, soutiendront certainement les académiciens, féminins au sens d’une analyse strictement grammaticale, ce sont bien les hommes pour l’essentiel qui sont les principaux acteurs de ce théâtre sordide sur le terrain des gladiateurs participants à la conquête des jeux de couronnes. L’écroulement de plus en plus à l'ordre du jour des différentes civilités que l'on se doit d’adopter chacun dans sa sphère bien déterminée et que l’on soit politique ou non n’est guère le fruit d’un hasard. Loin de moi une volonté de soutenir l’idée reçue de je ne sais qui selon laquelle chaque peuple n’a que les dirigeants qu’il mérite, mais nous conviendrons ensemble que ces nervis, ces « insulteurs de la République », ces politiciens immoraux, ces adeptes des opiums du populisme, ces propagateurs de discours haineux ou encore ces FDS prêts à fusiller à tout va, à tout moment et sans état d’âme ne tombent pas du ciel.

Ce couple conjoncturel (violence-politique) qui, on l’a désormais compris, s’est juré fidélité pour l’éternité, occupe en effet une place dans la société depuis belle lurette, si ce n’est depuis toujours. Et si même, ce n’est cette société qui représente parfaitement cette malheureuse tradition protégée aujourd’hui par la liberté de pensée politique au nom d’une démocratie importée et inadéquate. Ce que je défends par là, c’est que le militant sénégalais, de tous bords, c’est celui qui a soif d’éducation politique et non d’immunité juridique. Évoquons dans cette dynamique l’article L117 du code électoral de 2021 : "De l’ouverture officielle de la campagne électorale jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin, aucun candidat ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des propos tenus ou des actes commis durant cette période et qui se rattachent directement à la compétition". Quelle est la logique d’une telle disposition, si ce n’est de conférer légalement et maladroitement à certaines élites de la société le pouvoir de subtilement dribbler un ordre social qui devrait être l’affaire de tous, sans déroute et pour tous : un climat social convivial, apaisé et serein. Rien que l’intitulé de la section deuxième où loge cette disposition que je qualifierai de pur narcissisme de la part du conglomérat des acteurs politiques à travers le législateur sénégalais porte à confusion : immunité et prescription en matière électorale.
Mes confrères juristes ne manqueront sûrement pas l’occasion de me rappeler qu’immunité n’est pas synonyme d’impunité. Cependant, il est indéniable que nul n'ignore les caractères vicieux et sournois de nos hommes politiques, capables, tout comme nos pairs avocats, de se donner des coups et de vomir les uns sur les autres devant les objectifs de cette brillante invention d’Étienne-Jules Marey, pour se retrouver finalement sur la terrasse d’un restaurant à discuter des courbes de la jolie demoiselle, d'un doublé de Messi ou d’un triplé de Ronaldo. Pardonnez-moi de vous importuner avec mes remarques qui ne manifestent rien d’autre que le désir ardent d’un apprenti écrivain de manier la langue, mais vous devez comprendre que mes adversaires du jour, vos politiciens, ne méritent pas tant d’élégance juridique. Je n’affirme rien de personnel, c’est simplement un constat véridique, hélas !

Un constat qui ne peut se limiter à notre époque contemporaine. Aujourd’hui, il est admis que 70 % des actes de violence perpétrés au Sénégal seraient, selon les statistiques du Gorée Institute, le fait de jeunes âgés de 25 ans au plus. On pourrait aussi se demander quelle était la configuration de l’arène politique depuis l’accession de notre État à la souveraineté internationale, à savoir l’après-indépendance. Les années 1960-1966 ont été marquées par la terreur, la répression, la destruction massive et collective des idéologies et des positions dissidentes. SENGHOR, premier président de la République du Sénégal, marqua son époque par la répression des manifestations post-électorales du 1er décembre 1963 et celle du rassemblement de mai 1968. Sans devoir faire la radiographie des différents points noirs de notre démocratie après cette période, on peut incontestablement affirmer que cette dernière, tant citée en exemple dans la sous-région, n’est pas si distincte de l’allégorie des épines sur les roses.
Par ailleurs, une analyse uniquement narrative et juridique de la politique comme cadre d’expression de la violence n’est que pure « masturbation intellectuelle ». Oups ! Pardonnez-moi encore une fois pour mes termes malencontreux ! Ce que je veux dire, plus poliment, c’est qu’il nous faut pousser la réflexion au-delà du carcan des seuls politiques. Ceci revient à faire, en sus de l’analyse extrêmement ciblée (systémale), une autre se fondant sur le systémisme (systémique et donc plus large et objective). Pour ce faire, quoi de mieux que de lancer un coup de fil aux sociologues connus pour leur rigueur dans l’usage des techniques d'enquête fondées sur la pratique sociale des individus ? Et encore mieux, qui d’autre que Alexandre Lacassagne, fondateur de l’École du milieu social, Gabriel Tarde, penseur de la psychologie sociale, Émile Durkheim, chef de file de l’École sociologique, ou encore Enrico Ferri, auteur de La sociologie criminelle, pour abattre ce travail scientifique ? Ces derniers proposent différentes interprétations sociologiques du phénomène criminel et de la violence sociale par ricochet. De ces penseurs, on peut retenir qu'ils considèrent la violence comme une maladie sociale, qui n'est pas accidentelle, mais qui découle, dans certains cas, de la constitution fondamentale de l'être vivant. Ainsi, la sociologie soutiendrait que la société façonne les circonstances dans lesquelles l'activité criminelle, et donc la violence, se manifeste. En d'autres termes, la société influence les individus à commettre des crimes. Comme le disait le philosophe Rousseau : « l’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt ». Cela soulève la question suivante : qu’a donc fait ma société pour mériter de telles inepties de la part de ses membres ?
En suivant cette logique, la violence trouverait son terrain de prédilection non pas dans l’arène politique, mais plutôt dans les interstices de la vie sociale. On évoque alors les violences familiales et conjugales, les violences à l’école, la violence urbaine ou celle des banlieues, ainsi que la « violence dans les médias », la violence au travail, la criminalité et la pédophilie, sans oublier « ces violences qu’on ne voit pas » (comme l’immigration, le handicap ou les maltraitances invisibles), la violence des enfants, la violence juvénile, les ambiguïtés de la figure de la victime et la « culture de la peur ». De la violence politique en démocratie par Denis Merklen. Partant de ce postulat de Merklen, ce ne sont plus des hommes pris à part qui seraient la tâche noire sur la chemise blanche, mais plutôt le prolongement d’un noyau du système corrompu dès sa formation. Le ring des politiciens ne peut être considéré autrement que comme un cadre d’expression, faisons de lui un simple vecteur où la tâche noircie depuis le starting-block trouve les conditions idoines, adéquates et légitimées pour se défouler sans être trop inquiétée (l’exemple du cadre juridique développé plus haut).
Faire un décryptage d’un phénomène social est une chose, saisir et comprendre la réaction des individus face à un tel phénomène en est une autre.
Selon la conception durkheimienne, dans chaque groupe social, il existe un certain nombre de consensus sur certaines normes. La violation de ces normes, institutionnalisées ou non, est appelée acte de déviance ; comment notre société réagit-elle face à cette violation ? Sur notre thème (violence politique), nous ne pouvons faire appel qu’à la société civile. Pas celle des seules organisations regroupant, pour la majeure partie, de faux civils avec la double casquette de politiciens pendant les jours du seigneur, mais celle qui prend en compte, entre autres, les chefs religieux, les intellectuels, les professionnels des médias, les étudiants, les organisations indépendantes… Tout ce beau monde se doit, dans l’optique de préserver notre tissu social, de demeurer impartial tout en restant impassible face à la vérité. L’exemple typique n’est rien d’autre que celui des journalistes ou chroniqueurs, deux métiers qui font souvent l'objet de confusion devant le public profane et qui de jour en jour, d’année en année, perdent leur crédibilité dans le traitement de l’information pour de modiques privilèges, traînant ainsi dans du poto-poto leur blason d’antan. Outre les médias, si le Sénégal a toujours fait exception dans l’Afrique subsaharienne, c’est aussi grâce à ses régulateurs sociaux, qu’ils soient religieux ou non. Autrefois capables de titiller le petit prince, refusant de se réduire à curer les sabots de ses chevaux, aujourd’hui la dignité de ces hommes de Dieu (ou des dieux) est pour la plupart en berne. Et pourtant, placer le tandem éthique et équité dans leur indignation et leur condamnation des actes de déviance pourrait bien constituer un début de solution pour résoudre les phénomènes socio-politiques auxquels nous faisons face.
Cependant, cette solution, bien que louable, ne peut être assez efficace car elle est uniquement à but curatif. Il existe une autre approche, beaucoup plus préventive, évoquée en début de raisonnement : l’éducation du peuple par le peuple.
En vérité, ce n’est plus un secret, tout amateur de débats politiques pleure aujourd’hui les cendres de l’époque où les partis politiques faisaient école. Ce renouement avec la tradition des écoles du parti devrait permettre de remettre en place la force dite des arguments en lieu et place de « l’argument de la force » qui sévit maintenant depuis fort longtemps. L’école du parti fondée par les socialistes en 1978 constitue toujours un exemple qui fait l’unanimité chez les différents acteurs, même si ce dernier a tantôt dans son cursus formé des lourdauds et des tonneaux vides qui participent jusqu’à présent à polluer l’atmosphère politico-sociale. Le doyen Alioune Dramé, journaliste et ancien pensionnaire de l’école du parti, disait à ce sujet : ‘’Les honnêtes citoyens en émoi, impuissants, ont fini par se détourner de la politique, ce noble art de gérer la Cité, aujourd’hui détourné de son essence et de sa finalité par d’autres intrus, sans parcours académique et vécu politique, qui polluent l’atmosphère de leurs nuisances sonores’’.

En tout état de cause, aujourd’hui, le Sénégal se trouve à un tournant décisif pour son avenir dans le cercle des pays émergents ou développés. En sus de l’exposition de nos frontières au phénomène du terrorisme, l’exploitation en cours des nombreuses ressources naturelles que le ciel nous a fait don nécessite de tourner la page des politiques politiciennes et d’ouvrir à jamais celle des politiques publiques.

Néanmoins, avant la construction des infrastructures que je considère comme étant l’élévation des murs de l’État, pris tel un chantier lambda, faisons d’abord de l’humain un citoyen modèle qui serait le fondement de ce chantier plein de gravats.
Ken Yaya SAGNA
ARTICLES :
Érudit: réaction sociale à la déviance; Bathily Abdoulaye: mai 1968 à Dakar; Marc Le blanc et Nguyen Thi-Hau: Réactions sociales à la déviance; Jean-Jacques Rousseau: Discours sur les sciences et les arts; Journal enquête+ du 30 novembre 2024; Sénégal code électoral 2021.
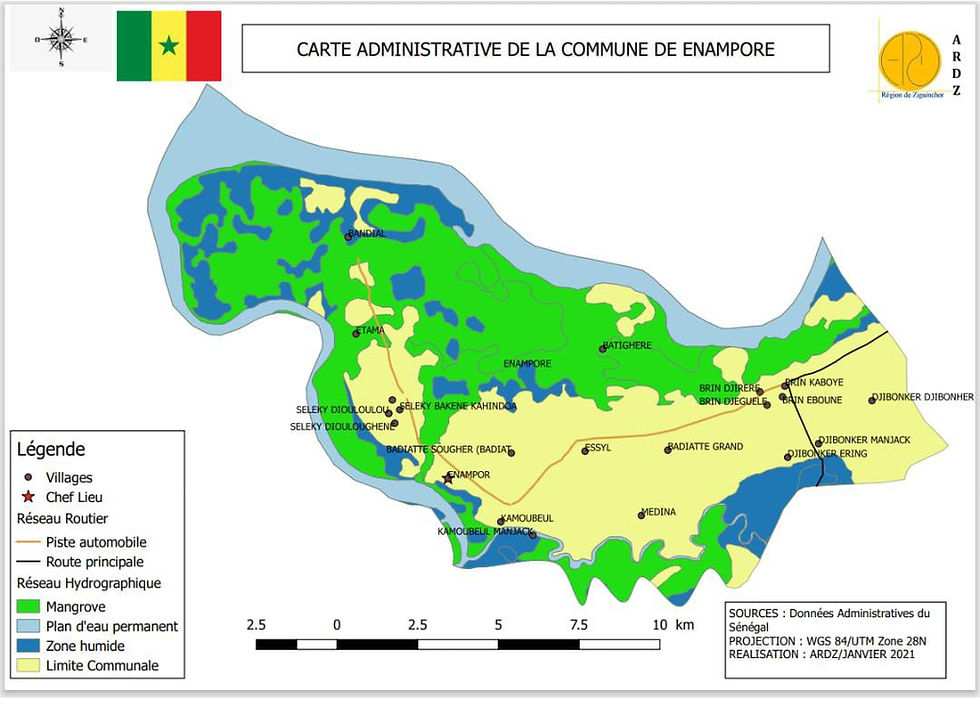
コメント